Par J. A. Ansah
Contributeurs : Révérend Barnabas Ankrah, Raymond Awadzi
Introduction
La canonisation est l’acte formel par lequel l’Église déclare qu’une personne décédée est un saint, digne de vénération et, dans la tradition catholique, capable d’intercéder pour les fidèles (Jean-Paul II, 1983). C’est un processus qui implique une enquête rigoureuse, des témoignages, et généralement la confirmation de miracles.
Un prophète, toutefois, n’est pas une simple figure spirituelle. Au sens biblique, un prophète est une personne appelée, mandatée et investie directement par Dieu pour proclamer Sa parole à Son peuple (Jérémie 1:5 ; Amos 7:15). L’autorité du prophète ne vient ni de conciles ecclésiastiques ni de votes de congrégation, mais de la volonté divine elle-même.
« Le prophète n’est pas fait par les hommes, mais choisi par Dieu pour le bien du peuple » (Homélies sur Jérémie, 1.1).
La thèse centrale de cet article est simple : canoniser les prophètes est inutile, théologiquement problématique, logiquement erroné et historiquement inexistant. En réalité, cela risque de réduire leur mission, confiée par Dieu, au niveau d’une bureaucratie ecclésiastique — comme si Élie avait besoin de remplir des formulaires.
Contexte historique de la canonisation
Selon l’Encyclopédie Britannica, le premier saint canonisé par un pape fut Ulrich, évêque d’Augsbourg, mort en 973 et canonisé par le pape Jean XV lors d’un synode au Latran en 993. Le pape Alexandre III (1159–1181) commença à réserver les causes de canonisation au Saint-Siège, et cela devint loi générale sous le pape Grégoire IX (1227–1241).
Le processus actuel de canonisation, tel qu’il existe dans le catholicisme, s’est développé au fil des siècles. Dans l’Église primitive, les saints étaient souvent proclamés par acclamation populaire, surtout les martyrs. Avec le temps, des abus et incohérences amenèrent à la centralisation papale de la procédure, amorcée au XIIe siècle sous Alexandre III (Woodward, 1996).
Canonisation dans d’autres Églises
Dans l’Église orthodoxe orientale, la canonisation est une proclamation solennelle plutôt qu’un processus judiciaire. La dévotion spontanée des fidèles envers un individu constitue généralement la base de la sainteté. L’évêque examine la requête, puis la transmet à une commission qui rend une décision finale.
Dans l’Église anglicane, une commission fut nommée en 1950 et débattit, notamment lors de la Conférence de Lambeth en 1958, de la possibilité de canoniser des membres de sa propre communion.
Les critères pour la sainteté devinrent clairs : preuve de vertu héroïque, orthodoxie doctrinale et miracles posthumes. Aucun prophète biblique, de l’Ancien ou du Nouveau Testament, ne fut jamais canonisé — ni Moïse, ni Élie, ni Ésaïe, ni Jean-Baptiste (bien que le Christ Lui-même l’ait qualifié de « plus qu’un prophète » en Matthieu 11:9–11) — et, bien sûr, cela ne devrait pas arriver au Prophète C. K. N. Wovenu. Leur sainteté était évidente, attestée par l’Écriture et la tradition.
En résumé, le témoignage biblique et la tradition chrétienne primitive considèrent déjà les prophètes comme une catégorie distincte — supérieure en fonction aux saints, et donc hors du champ de la canonisation.
Arguments théologiques contre la canonisation des prophètes
Statut biblique des prophètes :
Les prophètes sont directement désignés par Dieu :
- Jérémie 1:5 : « Avant que je t’aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais ; avant que tu sois sorti de son sein, je t’avais consacré ; je t’avais établi prophète des nations. »
- Amos 7:15 : « L’Éternel m’a pris d’auprès du troupeau, et l’Éternel m’a dit : Va, prophétise à mon peuple Israël. »
Jean Chrysostome affirma :
« C’est Dieu qui met à part Ses prophètes ; les mettre à part une seconde fois, c’est agir comme si Son choix était insuffisant. » (Homélies sur Matthieu, 2.3)
Canoniser un prophète revient à dire que l’Église doit “ratifier” la décision de Dieu — une absurdité théologique. Si Dieu les a déjà établis pour un ministère divin, qu’ajouterait la canonisation humaine ? C’est comme décerner un prix Nobel à la gravité — cela ne la rend pas plus importante ; cela donne juste l’impression que nous nous donnons beaucoup de mal pour rien.
Distinction entre prophètes et saints
Les saints sont vénérés avant tout comme modèles de vertu et intercesseurs après leur mort. Les prophètes, eux, sont les canaux directs de la révélation divine, souvent porteurs de messages d’avertissement ou de jugement.
Risque : confondre ces rôles revient à faire des prophètes des “mascottes sacrées” plutôt que des hérauts divins — une rétrogradation spirituelle comparable à déclarer qu’un proviseur défunt devient « délégué de classe ».
Risque d’idolâtrie
L’histoire montre que la canonisation mène souvent à la vénération de reliques, d’icônes et à des fêtes liturgiques. Pour un prophète, cela détournerait l’attention de son message (qui est celui de Dieu) vers sa personne (ce qui n’est pas l’objectif). Même Moïse, après sa mort, eut un lieu d’enterrement gardé secret par Dieu (Deutéronome 34:6) — peut-être précisément pour éviter tout culte de reliques.
Saint Augustin suggère :
« De peur que le peuple… ne fasse du serviteur un idole et oublie le Seigneur. » (Cité de Dieu, 8.27)
Arguments logiques et de bon sens
- Redondance : canoniser un prophète, c’est comme remettre le prix de “l’employé du mois” au PDG fondateur de l’entreprise — le titre n’ajoute rien à son autorité.
- Infaillibilité problématique : les prophètes n’étaient pas parfaits. Jonas a fui l’appel de Dieu (Jonas 1:3). Moïse a frappé le rocher avec colère au lieu de lui parler (Nombres 20:11–12).
- Problème de sélection : lesquels canoniser ? Tous ? Certains seulement ? Risque de chaos théologique.
Réfutation des arguments en faveur
- “Cela inspirera les fidèles” — Leurs écrits inspirés le font déjà (Romains 15:4).
- “Cela confirme leur sainteté” — L’appel de Dieu est déjà la plus haute confirmation (Galates 1:1).
- “Cela unit l’Église” — Les débats sur les reliques et les fêtes ont historiquement causé plus de divisions que d’unité.
Exemples pratiques et comparaisons religieuses
- Moïse canonisé : circuits touristiques rivaux pour “voir” le buisson ardent.
- Élie canonisé : vente de “manteaux d’Élie” en polyester made in China.
- Jonas canonisé : croisières “pèlerinage de foi” avec option baleine (non remboursable si absente).
Comparaison interreligieuse
- Judaïsme : les prophètes sont honorés pour leur message, sans culte ritualisé.
- Islam : les prophètes sont respectés, mais jamais transformés en intercesseurs.
Leçons importantes sur la canonisation et les prophètes
(Texte repris et traduit fidèlement des quatre points de votre article)
- Reconnaître l’intention et la discipline des Églises établies
- Honorer l’excellence organisationnelle des Églises historiques
- La préoccupation centrale : certification humaine de nominations divines
- La nécessité d’un dialogue ouvert et éclairé
Conclusion
Les prophètes ne sont pas des saints en attente — ils sont des messagers désignés par Dieu, déjà mis à part dans une catégorie unique. Les canoniser ne les élèverait pas, mais risquerait de réduire leur rôle spécifique en filtrant la nomination divine à travers une cérémonie humaine. Le rôle de l’Église n’est pas de certifier les prophètes, mais d’annoncer et d’obéir au message que Dieu a transmis par eux.
Bibliographie
Anderson, G. (2009). Why Moses could not be canonised. Journal for the Study of the Old Testament, 34(2), 147–165.
Augustine (2003). City of God. Trans. Henry Bettenson. Penguin.
Bauckham, R. (2006). The Jewish world around the New Testament. Baker Academic.
Brown, R. E. (1997). An introduction to the New Testament. Yale University Press.
Canonization. Encyclopædia Britannica. Last modified 2024.
Chrysostom, John. Homilies on Matthew. Nicene and Post-Nicene Fathers, Series 1, Vol. 10.
Congar, Y. (2000). Saints: Their canonisation and role in the Church. T&T Clark.
Hennecke, E., & Schneemelcher, W. (1991). New Testament Apocrypha. Westminster John Knox.
John Paul II. (1983). Divinus Perfectionis Magister. Vatican. [Apostolic Constitution on the Canonisation of Saints] https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_25011983_divinus-perfectionis-magister.html
Louth, A. (2007). Greek East and Latin West: The Church AD 681–1071. St Vladimir’s Seminary Press.
Murphy-O’Connor, J. (2004). Prophets and saints: Different charisms, different roles. Biblica, 85(3), 305–321.
Neusner, J. (1993). The idea of purity in ancient Judaism. Brill.
Origen (1998). Homilies on Jeremiah. Trans. John Clark Smith. Catholic University of America Press.
Schillebeeckx, E. (1987). Church: The human story of God. Crossroad.
Watt, W. M. (1971). Muhammad: Prophet and statesman. Oxford University Press.
Wainwright, G. (2010). For our salvation: Two approaches to the work of Christ. Eerdmans.
Woodward, K. L. (1996). Making Saints: How the Catholic Church Determines Who Becomes a Saint, Who Doesn’t, and Why. Simon & Schuster.
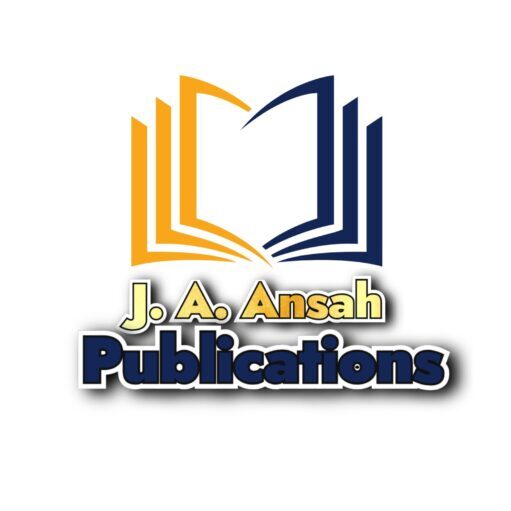



https://shorturl.fm/OcZb2
https://shorturl.fm/QAhj2